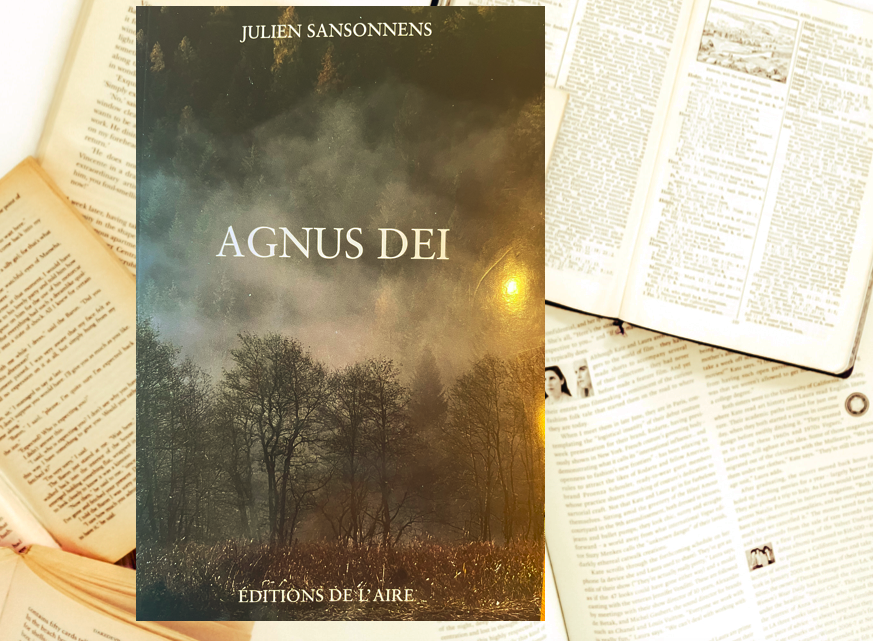« Oui, le village-rue, hameau enchâssé dans l’une des trois enclaves catholiques en terre vaudoise, aurait fait corps avec Marcel C., d’ailleurs on n’est pas loin de penser que l’authentique victime de cette vieille affaire, ce serait plutôt lui ; malgré le temps, on n’a rien oublié. Jeanne-Sarah est certes morte, et de quelle effroyable manière, cependant était-elle si pure qu’on ne puisse rappeler certaines évidences ? »
Ces soirées grises de novembre invitent à se plonger dans des récits sombres déterrant les faits-divers d’en-temps, revisitant le passé de nos régions campagnardes. Julien Sansonnens, originaire de la Broye, signe son cinquième roman avec « Agnus Dei », publié récemment aux Editions de l’Aire. Roman historique certainement, thriller du terroir par certains aspects, le livre déterre le cadavre d’un drame authentique, survenu dans les villages lacustres de la Broye fribourgeoise des années 40.
Marcel C., forgeron rustre et penché sur la boisson, finit par consentir, à l’aube de la trentaine, à épouser Jeanne-Sarah. Alors qu’il est appelé sous les drapeaux durant le conflit de 39-45, la félicité initiale de l’union s’effrite. Dans une région reculée où la doctrine catholique règne en maître, les conflits conjugaux se subissent, se dissimulent, de sorte à éviter l’opprobre du divorce. À cette époque, les bons conseils se cherchent dans la Bible ou auprès de l’Abbé. Face aux mœurs condamnables, les rumeurs du voisinage ne servent quà mettre de l’huile sur le feu. Ainsi, le jour où Jeanne-Sarah trahit son époux, on devine que celui-ci commettra l’impensable. Et sera condamné à quatorze années derrière les barreaux.
Le texte foisonne de références religieuses, la morale d’une Eglise modérant les rôles entre coupable et victime, condamnant l’adultère et les pulsions impies à même titre que le meurtre. L’auteur se met aisément dans la peau de chacun des partis. D’un côté, l’homme trompé ; de l’autre, l’épouse infidèle. Il évoque la dépendance, la violence conjugale, le sort des enfants placés dans une Suisse bien différente de la nôtre – une Suisse où l’on manque de tout.
Plus qu’une histoire d’amour qui tourne mal, le livre dépeint avec habilité le prosaïsme de nos villages d’il y a cent ans. En arrière plan, il rappelle la crise de 29, notre neutralité présumée lors du second conflit mondial, les privations et l’intrusion des étrangers dans nos campagnes. Historien à ses heures perdues, l’auteur s’adonne également à un exercice de style très habile pour susciter l’émotion à travers ses descriptions truffées d’images.
« À la fin des années trente, la Broye fribourgeoise est un marais asséché, assemblage de rectangles ocre, blonds et roux où montent les récoltes, morne plaine ornée de bourgs aux toits bas. Le territoire s’étend jusqu’aux derniers contreforts du Vully, colline arrondie et familière que l’on a comparée à un chat endormi. Villages resserrés autour de l’église, décorée d’or et de marbre, et du cimetière appondu, densité d’un silence seulement dissipé par l’angélus et le glas, continuité des semailles, des moissons et des jachères. »
Au-delà du plaisir de lire sur ce qui aurait pu être le quotidien de mes grands-parents -originaires de la même région que Marcel C.- la prose fluide m’a emportée, enchaînant d’une traite les 120 pages.
Editions de l’Aire, 2020.
Julien Sansonnens est titulaire du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne en 2022.