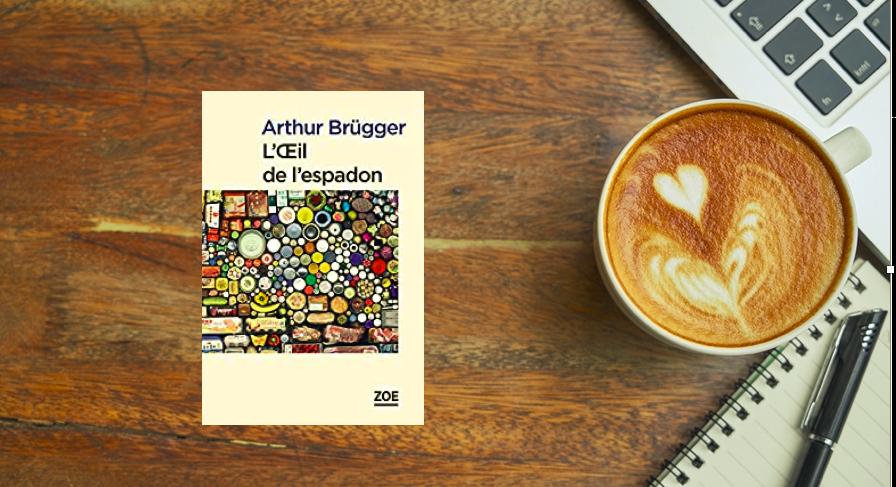« C’est la semaine de l’espadon. On a reçu deux énormes espadons et les clients peuvent pas s’empêcher de s’arrêter devant pour dire « oh comme ils sont jolis », « oh comme ils sont gros », « oh comme c’est dégoûtant », et nous on dit « oui oui » en hochant la tête. On répète à tout le monde que oui, ils viennent bien d’Italie. C’est marqué sur l’écriteau, mais les clients pensent qu’on en sait plus que l’écriteau, ou que peut-être l’écriteau ment. Couper des tranches d’espadon c’est pas vraiment évident à cause de l’os au centre, la colonne vertébrale qu’il faut briser avec le gros couteau qui ressemble à une scie. »
« L’oeil de l’espadon » est le premier roman du vaudois Arthur Brügger, diplômé de l’Institut littéraire suisse et récompensé par le Prix Bibliomedia en 2016. A mi-chemin entre le conte et le roman de société, il donne la parole à Charlie, apprenti-poissonnier, dans le décor d’un hypermarché.
Charlie est orphelin, timide avec les filles, toujours gentil mais effacé. Sa vie sociale et son travail ne forment qu’un : il évoque les horaires à rallonge de ces travailleurs de l’ombre que chacun croise derrière un gros caddie à commission sans s’interroger sur leur quotidien ; leur pause-café, obligatoire mais décomptée ; leur colère en entendant les chefs rappeler de travailler avec le coeur pour un salaire bas et une absence de considération ; leur agacement fasse à la pression du chiffre d’affaire ; les exigences d’obséquiosité envers une clientèle tantôt impatience et hostile, tantôt avide de contacts humains, qui racontent leur vie au petit poissonnier du Grand Magasin.
La vie sous les néons, au milieu des denrées alimentaires, est déployée devant nos yeux de lecteur à l’image d’un microcosme, régit par des règles qui lui sont propres et en même temps miroir de notre société.
Le livre aborde les thématiques de la solitude, de l’écologie à travers la dénonciation du gaspillage alimentaire, du statut des travailleurs pauvres. Le tout est conté avec une grande candeur par un narrateur à peine adulte, dont la propose cultive un côté enfantin.
« En tout cas les paquets on les emballe toujours la veille mais on met l’étiquette le lendemain comme ça la date sur l’étiquette elle est reportée d’un jour et le client il l’achète parce qu’il pense que ça dure plus longtemps. C’est pas de l’arnaque parce qu’en vrai la nourriture est mangeable plusieurs jours. C’est juste que le client il va toujours préférer le paquet où la date c’est le lendemain. »
Charlie parle avec humanité des poissons qu’il découpe et évide avant de les servir aux clients. Sa prose emprunte de poésie est la force de ce roman. J’y ai retrouvé le style narratif des livres du « Petit Nicolas » de mon enfance. Le protagoniste apprend toutefois, au fil du récit, à s’affirmer en tant qu’adulte, avec en suspens la question de savoir s’il va finir par se soustraire au système ou en adopter les codes et, en tant qu’employé modèle, gravir les échelons.
En effet, les personnages sont représentés avec leurs faiblesses et leurs contradictions, comme Emile, artiste embauché au sous-sol du supermarché, là où terminent les invendus dont on ne peut profiter en tant qu’employé. Emile est la figure de l’universitaire engagé, embauché dans l’idée de délivrer un reportage photo sur le gaspillage alimentaire ; il se heurte au personnage de Charlie, cette classe sociale moins encline à mener des actes citoyens car trop occupée à survivre au travail. Avoir des convictions, est-ce l’apanage de la bourgeoisie ?
Le récit est donc original, émouvant, et très éloigné des poncifs auxquelles il serait facile de céder en tant qu’auteur. Pas d’histoire d’amour avec la jolie Natacha dont il rêve secrètement ; pas d’acte d’héroïsme téméraire, juste la vie. A recommander à tout ceux qui aiment les livres mettant de la poésie dans l’ordinaire.
Editions Zoé Poche, 2015.