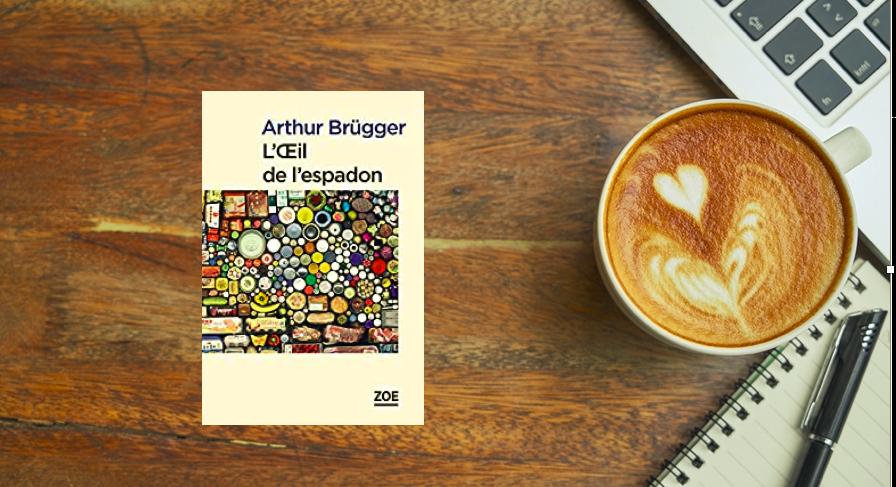Sur le pont – Charlotte Frossard
« – Ta mère aimerait pleurer ses morts ici. Mais elle ne peut pas.
– Est-ce que tu es fâchée qu’une partie de la famille soit partie ?
– Non. Pour se battre, il faut des gens qui restent et des gens qui partent.
Le silence ponctue l’échange.
– Oui, mais tu sais, Joana, je me souviens aussi quand j’étais petite. On voulait parler portugais mias il y avait toujours un moment où vous arrêtiez d’essayer de nous comprendre. Vous partiez tous ensemble à la plage sans me prendre avec vous. Et moi je restais, avec la bonne et ta grand-mère, à regarder la télévision portugaise, mais je ne comprenais que les images. Ce que je veux dire… c’est que…. vous non plus, vous n’avez pas essayé de nous faire de la place. »
Ce roman récupéré sur une étagère avant de sortir furtivement du dernier Salon du Livre de Genève est une nouvelle immersion dans la thématique de l’émigration et de la manière de se construire loin de ses racines. La protagoniste Louise, employée dans une grande chaîne de télévision suisse, a été élevée à la Chaux-de-Fond par une mère d’origine portugaise. Ses grands-parents ont quitté la dictature de Salazar dans les années 1960, opposés au régime et sa politique de terreur dans les colonies.
Louise reste à distance de la culture lusitanienne mais semble cultiver un sentiment de non accomplissement. L’homme qu’elle aime ne lui appartient pas ; depuis des années, elle travaille consciencieusement en tant que sous-fifre d’une cheffe ambivalente, prétendument son amie, en réalité contrôlante et manipulatrice, lui faisait miroiter un poste de journaliste jamais obtenu. Lorsqu’elle entend parler d’un concours de reportage sur le thème des dictatures du XXème siècle avec, à la clé, une porte d’entrée vers le métier, elle quitte son quotidien et s’en va revisiter ses racines.
D’abord à la Chaux-de-Fond, auprès de sa grand-mère, qui dévide les souvenirs de son enfance : les visites au père dans une prison d’état, le mariage, la décision de partir et la perte d’un enfant ; puis l’installation en Suisse, dans la cité horlogère, choisie pour s’éloigner du lac -cette reproduction si décevante de l’Océan qu’il amplifie la tristesse de l’exode.
Le roman teinté de faits autobiographiques délivre un regard nouveau sur la diaspora portugaise que l’on côtoie quotidiennement en Suisse romande, sans crier gare. Les noms de famille lusophones enrubannés d’un accent chantant font partie de notre paysage. On les imagine venir d’un petit village pauvre, au bord de l’océan ; on les imagine peinant à joindre les deux bouts, convoiter un permis B, travailler jusqu’à pas d’heures, investir le salaire dans la pierre, rentrer pour la retraite. Ou pas, si leurs enfants décident de rester, se marier, faire des enfants ici qui n’auront de portugais que le patronyme.
Dans la famille de la protagoniste et par extension, de l’autrice et journaliste genevoise Charlotte Frossard, l’histoire est un peu différente. L’arrière-grand-père de Louise, militaire de carrière, a combattu dans les tranchées de la guerre de 14 et de par sa fonction, était tenu de prêter allégeance à la politique d’Antonio de Oliveira Salazar lorsque celui-ci accède au pouvoir dans les années 30. Cette position particulière ainsi que son métissage renforce son sentiment de non-appartenance, ainsi que celui de sa mère, née en Suisse, désireuse de retrouver chaque été son pays d’origine mais toujours d’humeur triste lorsqu’elle y est. La famille ne fréquente pas les Centres culturels et la journaliste en devenir ne parle pas la langue. Au fil de son voyage, nous la voyons s’approprier cette part d’identité qui lui manque, alors qu’elle parcourt ce bout de terre, un carnet de notes à la main, de Porto jusqu’en Algarve.
Nous constatons dans l’intention de l’autrice une volonté de rappeler cette facette peu connue du pays qui, de nos jours, s’est transformé en destination touristique par excellence. Des dictatures érigées dans les années 30, nous retenons Hitler, Mussolini, Franco à la rigueur, tristement célèbres pour leurs guerres sanglantes. Le dictateur portugais a versé le sang surtout dans ses colonies et dans les couloirs secrets des prisons d’Etat, que la famille de Louise a connu.
« – (…) Et en plus, ce concours, c’est très difficile. Tu pensais faire sur quoi ?
– La dictature au Portugal, murmurai-je.
– La dictature au Portugal ? s’étonna-t-elle en riant. Tu dois confondre, ma Louise.
– Non, je t’assure, il y a eu une dictature au Portugal, jusque dans les années septante, balbutia-je à grand peine.
– Tellement insignifiante que personne n’est au courant. »
Au fil de ce récit non linéaire mélangeant l’enquête présente de Louise à son passé d’auxiliaire journaliste, j’ai appris que les méfaits de la dictature portugaise se constatent avant tout dans les colonies africaines et que les actes de Salazar, l’un des derniers dictateurs à perdre son influence coloniale, ont été peu condamnés par les puissances internationales qui craignaient, durant la Guerre froide, de se mettre à dos un Etat disposant d’un accès privilégié à la mer. La situation actuelle en Ukraine permet de confirmer que la guerre et les massacres nous concernent de plus près lorsqu’ils se passent sur le sol européen. Des dégâts trop lointains, des survivants souhaitant oublier, une précarité financière détournant les citoyens des affaires politiques… Tant de raisons pour lesquelles, peut-être, les années dictatoriales ont été laissées dans l’oubli, et retrouvent un peu de visibilité à travers la belle plume de l’autrice.
L’excellente émission radiophonique de la RTS a dès lors consacré un volet de cinq épisode à la dictature portugaise. Le dernier volet est consacré à l’histoire de « Sur le pont » : lien ici
Pour résumer, ce livre est un pont entre deux cultures, et par sa thématique très actuelle, permet de construire des ponts. Je recommande cette lecture.
Editions Encre Fraîche, 2022.